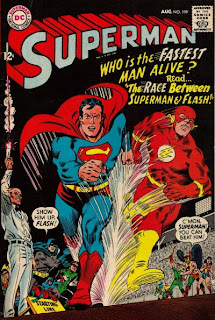Avengers Extra 6 :
- Captain America : Patriote (#1-4 : Né un 4 Juillet - Les Gagnants - Vérité et Justice - Patriote). En Juillet 41, Jeff Mace, reporter au Daily Bugle, croise la route de Captain America lorsqu'il neutralise des saboteurs allemands sur le territoire américain. Cette rencontre et l'appui de Mary Morgan, sa riche collègue, le motivent pour devenir à son tour un justicier masqué : Patriote. L'entrée en guerre des Etats-Unis en 1942, apès le bombardement japonais sur Pearl Harbor, le conforte dans son choix et il se joint aux Gagnants, une équipe de super-héros opérant sur le sol américain tandis que Captain America et les Envahisseurs agissent en Europe.
En 1946, Mace intervient aux côtés des Envahisseurs en Amérique et assiste à la mort de Captain America. Du moins le croit-il car il ignore que Steve Rogers a disparu en Europe un an avant et qu'il a été remplacé sous le masque. Le FBI lui propose alors de devenir le héros étoilé.
Mace joue son rôle tant bien que mal : Namor ne lui fait pas plus confiance que les autorités fédérales, surtout quand elles le soupçonnent d'entente avec une héroïne communiste (Mary Morgan, devenu Miss Patriote après avoir subi les expériences d'un savant fou). Le remplaçant de Bucky échappe de peu à la mort aussi. Il doit alors prouver son innocence et penser à sa reconversion...
Deux ans et demi après sa parution en vo, Panini a enfin réussi à trouver une place pour publier cette mini-série en 4 épisodes. Elle nous éclaire sur le cas d'un des remplaçants de Steve Rogers dans la période troublée de l'après-guerre, après qu'il ait disparu en affrontant le Baron Zémo avec Bucky.
Quand Stan Lee avait ramené Captain America dans les années 60 au cours du 4ème épisode d'Avengers, ses aventures publiées dans les années 50 étaient considérées comme effacées : Steve Rogers avait survécu dans un glacier pendant une quinzaine d'années avant d'être récupéré par les Vengeurs. Puis dans les années 70, Roy Thomas fit en sorte d'expliquer comment le Capitaine apparut durant la décennie où il était prisonnier des glaces en invoquant une série de remplaçants éphémères. Jeff Mace, le Patriote, était un de ceux-ci.
Karl Kesel, qui a bâti son récit avec l'aide de scénaristes experts en continuité Marvel (comme Kurt Busiek ou Mark Waid), imagine le destin de ce héros malgré lui, obligé d'endosser un costume et de jouer un rôle trop grands pour lui. Incarner une idole, le héros américain par excellence quand, déjà, on n'était qu'un justicier inexpérimenté, improvisé, supporter le poids de cet héritage mais aussi composer avec les autorités fédérales qui vous emploient, la femme qui vous aime sans retour, des co-équipiers qui ne vous considèrent pas : tout cela est très bien traité.
Les quatre épisodes se déroulent sur un rythme soutenu, avec des séquences courtes, des ellipses efficaces, une narration où la voix-off est très présente (comme dans la série écrite par Ed Brubaker). Les amateurs de justiciers rétro seront comblés. On pourra juste déplorer que Kesel n'ait pas imaginé une intrigue plus inventive car tout cela manque un peu de folie, reste dans les clous, forme un exercice de style nostalgique un peu trop convenu qui ne décolle jamais.
L'autre singularité de ce projet est qu'il a été mis en images par le couple Mitch et Bettie Breitweiser. Mitch Breitweiser est un choix intelligent pour dessiner ces épisodes : son style nerveux et évocateur donne beaucoup de vie, de naturel à l'histoire. Il y a ça et là quelques maladresses dans le découpage, parfois un manque d'envergure sur certains plans ou au contraire des splash-pages inutiles, mais le résultat ne manque pas de vigueur et d'élégance.
Néanmoins son travail est éclipsé par la magnifique colorisation de son épouse, qui, encore une fois, a accompli des finitions incroyables. Elle utilise des camaïeux de bleus, de gris, rehaussés par des parties rouges, qui donnent une ambiance spectaculaire à la série, comme un document d'époque un peu terni. C'est superbe (même si, apparemment, cela a pesé sur les délais de production : débutée en Novembre 2010, la série a été achevée en Février 2011, deux mois ayant été nécessaire pour boucler le dernier chapitre).
*
- Captain America et l'Agent Carter : "Cherchez la femme !". En France, en 1943, Peggy Carter travaille avec la résistance et des agents américains infiltrés, dont Captain America, pour une mission stratégique : empêcher les occupants allemands de récupérer des lunettes à vision thermique conçues par les japonais...
Pour compléter le sommaire de la revue, Panini a eu, pour une fois, la main heureuse en ne nous infligeant pas un bouche-trou insipide mais un récit écrit par Kathryn Immonen et illustré par Ramon K. Pérez. Il s'agit de revenir, là aussi, dans le passé de Cap', lors de la seconde guerre mondiale, et plus précisément sur sa liaison avec Peggy Carter, l'aïeule de Sharon (son actuelle petite amie - ce qui produit quand même un sentiment étrange quand on pense que le même homme couche avec la petite fille de son premier amour...).
Kathryn Immonen déjoue en vérité les attentes en livrant un épisode qui reste à distance du sujet convenu : elle nous montre les deux amants se chamaillant sur la tactique à adopter pour leur mission, et leur seul vrai moment romantique se résume à un baiser après le combat, tandis que leurs partenaires les observent grâce l'équipement volé. En vérité, Captain America et Peggy Carter partagent davantage le goût de l'action, du danger, et le dénouement est mélancolique, soulignant la précarité de leur liaison.
Les dessins sont assurés par Ramon K. Pérez, qui a adapté Tale of Sand de Jim Henson (même si cet épisode est antérieur à son roman graphique). Le résultat est amusant, subtilement décalé, la rondeur du trait, l'expressivité quasi-cartoony de l'espagnol contrastant avec la noirceur du contexte.
Mais c'est une réunion bien pensée avec Kathryn Immonen qui, elle aussi, a évité les écueils de la reconstitution et de l'hommage.
*
Bilan : un excellent rapport qualité/quantité/prix pour cet "Extra" de 128 pages servi par deux équipes artistiques excellentes et deux histoires originales.
Ultimate Universe Hors Série 2 :
Ultimate Iron Man : Démon en Armure (#1-4). Alors qu'il fait face à plusieurs attaques menaçant son entreprise et son rôle de super-héros, Tony Stark alias Iron Man se souvient des relations conflictuelles qu'il entretenait avec son père, Howard, pour se sortir de ce mauvais pas. C'est en effet dans le passé que se trouve la solution pour identifier et vaincre (peut-être) le mystérieux Mandarin...
La lente décrépitude de l'univers Ultimate (depuis... la saga Ultimatum ?) semble inéluctable, irréversible : les ventes des trois séries (Ultimates, Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men) sont en berne, les équipes artistiques se succèdent sans retrouver le panache des grandes heures de la ligne (Mark Millar et Bryan Hitch, Brian Michael Bendis et Mark Bagley puis Stuart Immonen...). Je ne serais pas étonné qu'en 2014 Marvel arrête les frais, surtout que de récentes initiatives (comme le crossover Spider-Men ou l'arrivée de Monica Chang dans la nouvelle série Avengers A.I.) prouvent que les univers Ultimate et 616 sont de plus en plus poreux.
Cette nouvelle mini-série Ultimate Iron Man démontre elle aussi à quel point cette gamme a perdu de son intérêt. En soi, ce n'est pas mauvais et d'ailleurs elle bénéficie d'une bonne équipe artistique : le scénariste Nathan Edmondson (auteur du brillant Who is Jake Ellis ? chez Image) conduit son récit avec un sens du rythme très assuré, l'intrigue n'est pas renversante et son dénouement est à la fois frustrant et précipité mais ça se lit sans ennui, explicitant des points du passé de Tony Stark et invoquant un "Ultimate Mandarin" avec astuce.
Graphiquement, l'italien Matteo Buffagni n'est pas maladroit non plus : dans les bonus de la revue (pour une fois que Panini en offre - ce qui n'est pas de trop pour un HS de 87 pages à 5,50 E...), on découvre qu'il compose ses planches avec un storyboard traditionnel avant de réaliser ses planches digitalement (dessin et encrage). Son point fort reste la composition, avec des plans et des séquences bien aérées et disposées, d'une lecture agréable. Il a cette aisance que possèdent beaucoup d'artistes italiens pour représenter les personnages, les décors, pour monter les scènes, même si c'est parfois un peu hésitant encore (et desservi par une colorisation très fade signée Andy Troy).
Seulement voilà, même si c'est plutôt bien fait, distrayant, rien n'est vraiment digne du cahier des charges originel de la gamme Ultimate : quand Millar et Bendis animaient cet univers en s'y autorisant tout ce qui n'était pas possible dans le 616 (morts de personnages emblématiques, politisation des intrigues, révision des rerlations entre les héros et leurs ennemis), bref, tout ce coté échevelé, débridé, décomplexé, inattendu et excitant (même si tout n'était pas toujours brillant), hé bien, tout cela a disparu.
Cette histoire aurait très bien pu se passer dans l'univers 616 sans problème, ou ne pas se passer du tout. C'est en définitive très quelconque, très sage - trop sage. Quel est l'objectif de cette mini-série ? En vérité, elle semble n'avoir été initié que pour accompagner la sortie du troisième film consacré à Iron Man, dans lequel il affronte... Le Mandarin. Et cette impression est renforcée par la rapidité exceptionnelle avec laquelle Panini a traduite cette histoire, dont la publication en vo s'est achevée en Mars, il y a juste un mois !
*
Bilan : pas mal, mais très dispensable en fin de compte. L'Ultimate-verse sent le sapin...